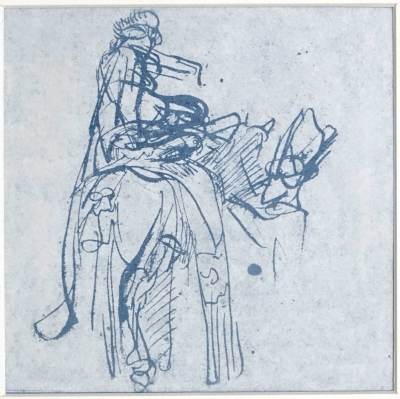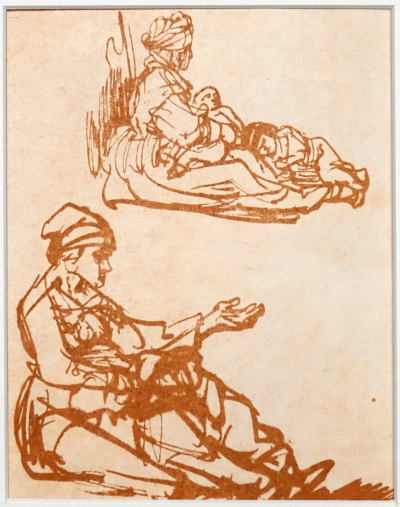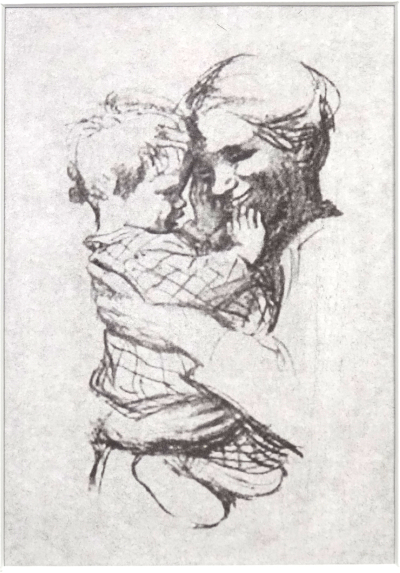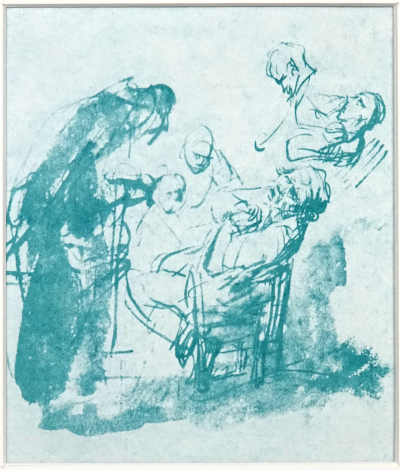|
Technique
de la gomme bichromatée
La
technique de la gomme bichromatée a été inventée dans le but de
reproduire des œuvres sans être obligé de les
graver. La gravure était la seule technique de reproduction
qui existait jusqu'au milieu du XIXe siècle (voir l'exemple de
la très belle gravure
au burin de J. B. Danguin
(1823-1894) du portrait d'Hendrickje
Stoffels de 1654
et la presse en bois
de la maison
de Plantin à Anvers). La découverte des
procédés de reproduction photosensibles (dont la technique de
la gomme bichromatée fait partie) aux environs de 1850 et dans
le domaine de l'imprimerie l'invention de la Linotype (Ottmar
Mergenthaler) et de la Monotype (Tolbert Lanston) vers 1880
révolutionnèrent les techniques de reproduction. Ils avaient
pour but la reproduction d'œuvres plus facilement que l'utilisation de la gravure
et surtout permettre de faire un très grand nombre de tirages.
En 1832, Gustav Suckov découvrit la sensibilité à la lumière
des chromates. En 1839, Mungo Ponton s'aperçut qu'un papier
imbibé d'une solution de bichromate de potassium était
sensible à la lumière. En 1840, Edmond Becquerel remarqua que
l'on pouvait augmenter la sensibilité à la lumière si le
papier était enduit d'amidon ou de gélatine. En 1852, William
Henry Fox Talbot montra que les colloïdes, comme la gélatine
ou la gomme arabique devenaient insolubles après mélange avec
du bichromate de potassium et après exposition à la lumière.
En 1855, Alphonse Louis Poitevin breveta le procédé au
charbon, qui consiste à ajouter du charbon au mélange colloïde
+ bichromate de potassium. En 1858, John Pouncy utilisa des
pigments colorés avec le mélange gomme arabique + bichromate
de potassium, définissant la technique de la gomme bichromatée
et obtint les premiers tirages en couleur. Le grand
photographe qui a utilisé la technique de la gomme bichromatée
au début du XXe siècle est Robert
Demachy.
L'aquarelle ou la gouache sont
principalement constituées d'un liant, la gomme arabique qui
est de la sève d'acacia, et de pigments qui définissent la
couleur. La gomme arabique est une colle soluble dans l'eau.
Elle est dite réversible, car après séchage elle peut être
dissoute de nouveau dans l'eau. Les peintures utilisant la
gomme arabique comme liant sont réversibles, lorsqu'elles sont
peintes et sèches, elles peuvent être lavées car la gomme
arabique se dissout dans l'eau. Si au mélange eau + gomme
arabique + pigment, on ajoute du bichromate de potassium, on
obtient une peinture photosensible qui après exposition aux UV
devient insoluble. Pour effectuer un tirage à la gomme
bichromatée, on peint sur du papier aquarelle une couche du
mélange photosensible. Lorsque la couche photosensible est
sèche, on la recouvre d'un négatif et on l'expose aux
rayonnements UV. Après exposition, on met le papier dans
l'eau. Les parties de la couche photosensible qui ont été
exposées aux UV adhèrent au papier, les autres vont se
dissoudre dans l'eau. On peut donc reproduire, une photo, un
dessin, une gravure ou une fleur ... en utilisant la technique
de la gomme bichromatée. On peut superposer plusieurs tirages
de couleurs différentes. C'est une technique qui se situe
entre la gravure, l'imprimerie, la peinture et la
photographie. C'est un procédé simple qui donne de très beaux
résultats.
Cette technique est
particulièrement bien adaptée pour reproduire les dessins et
les gravures de Rembrandt. Elle ne fournit pas une simple
copie, elle permet d'obtenir des tirages stables qui sont plus
beaux que des photographies. Elle offre donc la possibilité
d'explorer et de présenter le monde fascinant des dessins de
Rembrandt et d'étudier leurs liens avec ses eaux-fortes.
Cependant, c'est un procédé artisanal qui est long à mettre en
œuvre
et ne permet pas des tirages en grand nombre.

Omval (1641), {Rijksmuseum,
Amsterdam},
représente un vilage situé aux abords d'Amsterdam, le long
de l'Amstel. Cette gravure est une œuvre emblématique de
Rembrandt, dans laquelle il capture la vie sur le fleuve :
un piéton échange avec les occupants d'un bateau qui passe,
tandis que, presque imperceptibles, des amoureux se cachent
dans le feuillage derrière un arbre. Ces derniers
symbolisent la liberté face aux conventions religieuses,
constituant ainsi un pied de nez de Rembrandt aux autorités
religieuses qui l’avaient condamné pour sa conduite de vie
jugée immorale. Cette gravure respire la vie, loin
de donner l'impression d'une image figée. Pour Rembrandt, le
village d'Omval, pourtant sujet de la gravure, devient
secondaire par rapport à la vitalité de la berge et du fleuve.
On remarquera, en haut à droite de la gravure, de petits
traits réalisés par Rembrandt pour tester la pointe qui lui
permettait d'attaquer la couche de vernis. Fidèle à son esprit
libre et indifférent au "qu'en-dira-t-on", Rembrandt est l'un
des très rares graveurs à laisser sur sa plaque ses essais ou
même ses erreurs.

Le moulin De Run à Omval (circa 1688-90), {Rijksmuseum,
Amsterdam}, est une gravure réalisée par
Jan Vincentsz van
der Vinne, d'après Laurens
Vincentsz van der Vinne. Cette gravure,
produite environ cinquante ans après celle de Rembrandt,
représente également la vie sur le fleuve à Omval. Sur le plan
technique, il s'agit d'une très belle gravure. Cependant, elle
illustre clairement la différence de traitement des sujets
entre Rembrandt et ses contemporains, soulignant la liberté et
l'expressivité uniques que Rembrandt insufflait dans ses
dessins et gravures.
Rembrandt avait une très forte personnalité, il ne se
laissait jamais influencer par le qu'en dira-t-on, les
conventions et les changements de mode, son seul souci était
de représenter la vie telle qu'elle était et il se laissait
guider par une inspiration et une vision hors du commun.
Cette manière de faire égara beaucoup de ses contemporains
et des grands collectionneurs. Citons par exemple La
ronde de nuit (1642), la toile fut
admirée mais dérouta. Sa toile La
conspiration des bataves sous Claudius Civilis (1661), peinte à la demande de la mairie
d'Amsterdam fut rejetée par celle-ci. Enfin certaines de ses
gravures, jugées immorales ou vulgaires ne furent jamais
acquises par certains grands collectionneurs. Sa manière de
vivre était jugée immorale par les autorités religieuses et
beaucoup de ses contemporains, et notons que même au faîte
de sa gloire, il ne fut jamais invité au château de Muiden,
où se retrouvaient les cercles influents de la vie
artistique d'Amsterdam.
Sa vie sentimentale ne fut pas un long fleuve tranquille.
En 1634, il se marie avec Saskia van Uylenburg, son grand
amour. Ses trois premiers enfants ne survivront pas, seul
le quatrième Titus deviendra adulte. Saskia meurt en 1642.
Il se lie ensuite à Geertje Dircx, mais sa nouvelle
liaison avec Hendrickje Stoffels entraîne une rupture
particulièrement dramatique d'avec Geertje. Avec
Hendrickje, il a une fille, Cornelia. Hendrickje décède
probablement de la peste en 1663 et Titus meurt de la
peste en 1668, un an avant Rembrandt.
Ses œuvres contiennent
souvent des messages cachés. Citons par exemple, la toile
Le
retour du fils prodigue (1668 –
1669). Rembrandt voulait représenter le fils prodigue reçu
par son père et sa mère alors que sur la toile seul le
père reçoit le fils, il a donc suggéré la présence de la
mère en peignant une main de femme et une main d'homme au
père. C'est peint de manière tellement remarquable que ce
n'est pas choquant et ne se remarque pas au premier
regard. Dans la toile Paysage
au pont de pierre
(circa 1638), la lumière qui traverse un
ciel très sombre et tourmenté, éclaire le canal, le
pont et la ferme, lieux de vie, alors que l'église ne
reçoit aucune lumière.
Rembrandt en plus d'être
peintre, était également marchand d'art et un grand
collectionneur d'œuvres, d'objets divers
et vêtements qui lui servaient pour ses peintures. Il
était en conflit permanent avec les marchands d'art
car il voulait que les œuvres soient payées leur
juste prix. Ceux-ci se vengèrent quand ils le purent,
et se mirent d'accord lors de la vente consécutive à
sa faillite pour que les prix soient ridiculement bas,
entraînant une faillite colossale. Au sommet de sa
gloire, Rembrandt gagnait beaucoup d'argent, mais le
dépensait facilement, plusieurs facteurs dont un
placement hasardeux firent qu'il ne put plus
rembourser l'emprunt qu'il avait contracté pour
acheter sa maison. Après sa mise en faillite et la
vente de tous ses biens (1656 – 1658), Rembrandt
continua à peindre et produisit quelques-unes de ses
plus belles toiles. Il reçut quelques commandes, mais
mourut dans la misère. Après sa mort il ne
restait pas suffisamment d'argent pour lui payer une
tombe.

Autoportrait
(circa 1628-29, Benesch, B 54, circa 1629,
Schatborn & Hinterding,
D 628), {Rijksmuseum, Amsterdam},
est un dessin réalisé au pinceau et à la plume
pendant la période de Leiden. Il fait partie des
premiers autoportraits conservés de Rembrandt.
L'artiste réalisa de très nombreux autoportraits,
non seulement en dessin, mais aussi en gravure et en
peinture. Ces œuvres lui permirent, dès ses débuts,
de perfectionner sa technique de gravure, d'étudier
l'expression du visage pour exprimer différentes
émotions, telles que la peur, l'étonnement, etc.
Plus tard, ses autoportraits devinrent également un
moyen de suivre l'évolution de son visage tout au
long de sa vie. Sa dernière peinture est un
autoportrait. La principale
caractéristique de ses autoportraits réside dans
l'émotion et l'humanisme qui s'en dégagent. Dans ses
œuvres, il lui arrivait fréquemment de se représenter.
Lorsqu'il devint célèbre, de nombreuses personnes
désiraient acquérir un portrait de Rembrandt, ce qui
l'incita à réaliser encore davantage d'autoportraits.
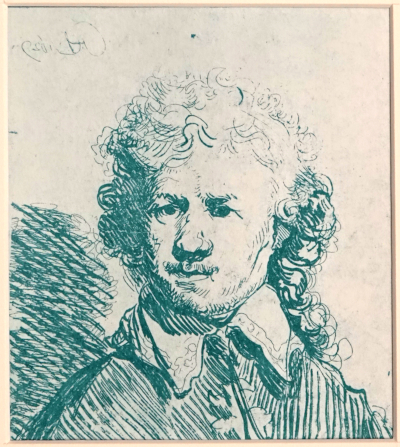
Autoportrait (circa 1629),
{Rijksmuseum, Amsterdam}, est une
gravure réalisée d'après le dessin Autoportrait de
1628-1629 (page 10). Il s'agit de l'une des
premières gravures de Rembrandt, qui avait commencé
la gravure dès 1625-1626. Afin de conserver la
souplesse du trait et sa spontanéité, Rembrandt
dessine directement sur la plaque de métal, comme il
le ferait sur une feuille de papier, et le tirage
est inversé. La méthode de gravure qui permet de
maintenir cette souplesse et cette spontanéité est
la gravure à l'eau-forte. Dans
cette technique, la plaque de cuivre est d'abord
recouverte d'un vernis. Rembrandt y dessine ensuite
avec une pointe fine, ce qui enlève le vernis. La
plaque est ensuite plongée dans un bain d'acide
(appelé eau-forte au XVIIe siècle), qui attaque le
cuivre là où le vernis a été enlevé. Il est
intéressant de comparer cette gravure avec celle de l'Autoportrait avec
l'avant-bras appuyé sur un rebord de pierre,
réalisée dix ans plus tard. Lorsqu'il dessine ou peint
un autoportrait, Rembrandt se regarde dans un miroir,
ce qui entraîne une inversion de l'image. Cependant,
lorsqu'il grave un autoportrait d'après un de ses
dessins, il reproduit le dessin sur la plaque de
métal, et le tirage de la gravure est inversé par
rapport au dessin original. Le tirage final devient
ainsi une représentation non inversée de Rembrandt,
comme on pouvait l'observer en réalité. Le plus bel
autoportrait de Rembrandt est probablement la gravure
de 1639, que l'on pourrait considérer comme une
véritable « photographie » de l'artiste à ce moment de
sa vie.
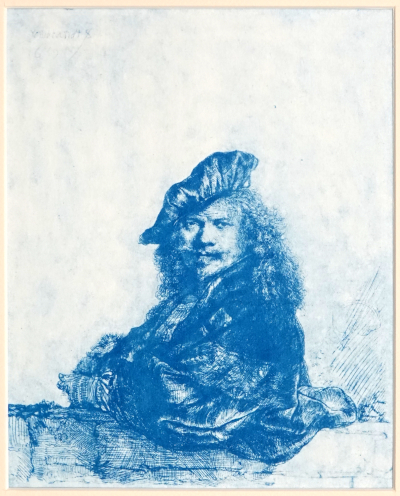
Autoportrait
avec l'avant-bras appuyé sur un rebord de
pierre (1639),
{Rijksmuseum, Amsterdam}, est une gravure à comparer avec l'Autoportrait de
1629. À cette époque, Rembrandt atteint le
sommet de son art de la gravure, réalisant
l'un de ses plus beaux autoportraits.
Cependant, sur le côté droit de la gravure,
il laisse un début d'esquisse ainsi que des
rajouts de traits au crayon (les pierres du
mur). Ces éléments suggèrent que ce tirage
est probablement l'un des premiers, et que
Rembrandt s'est posé la question de savoir
s'il allait continuer à travailler sur la
plaque. Finalement, il jugea que la gravure
était achevée et la laissa dans cet état. Ce qui semble l'intéresser avant tout
est la représentation de l'expression de son
visage et du luxe de ses vêtements. Les traits
esquissés indiquent également une forme de
nonchalance vis-à-vis des conventions
artistiques et une certaine distance par
rapport à l'image qu'il renvoie. Rembrandt
semble se moquer de l'idée de la perfection
formelle, privilégiant une représentation plus
spontanée et personnelle. Les ventes de
tirages de ses gravures constituaient une
source de revenus régulière et non négligeable
pour l'artiste. Cette gravure sera suivie de
la peinture Autoportrait
à l'age de 34
ans.
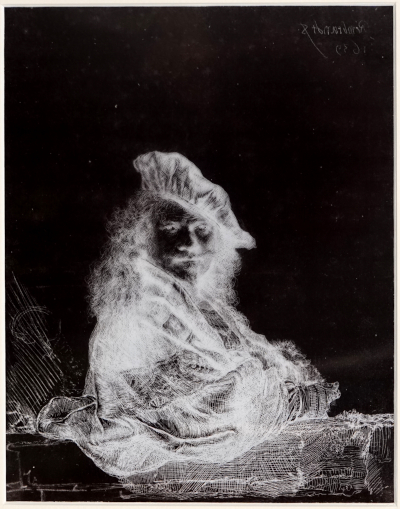
On peut voir ci-dessus le transparent
utilisé dans la technique de la gomme
bichromatée pour reproduire la gravure Autoportrait
avec l'avant-bras appuyé sur un rebord de
pierre de 1639. Le
transparent est placé sur la feuille peinte
avec l'aquarelle photosensible, et l'ensemble
est ensuite exposé aux rayonnements UV. Ces
rayonnements traversent le transparent dans
les zones blanches, qui sont transparentes. Après
l'exposition,
la feuille est plongée dans l'eau. Les parties de
la couche photosensible qui ont été exposées aux
UV adhèrent au papier, tandis que les autres se
dissolvent dans l'eau. Ainsi, on obtient la
reproduction de la gravure de Rembrandt. Le temps
d'exposition aux rayonnements UV dépend de la
couleur de l'aquarelle utilisée. Dans la technique
de la gomme bichromatée, le transparent joue un
rôle similaire à celui de la plaque de métal en
gravure, servant de support pour la reproduction.
Nous nous intéresserons aux dessins de Rembrandt,
ainsi qu'à ses gravures qui sont indissociables de
ses dessins. Les deux étaient le moyen privilégié de
Rembrandt pour mener à bien ses expériences, à
savoir comment représenter la vie telle qu'il
pouvait l'observer autour de lui. Rembrandt fut
l'un des plus grands dessinateurs et aquafortistes
de tous les temps. Il fut avec Katsushika Hokusai
(1760 – 1849) et Käthe Kollwitz (1867 – 1945),
celui qui exprima le mieux les sentiments des
humains et des animaux qu'il dessinait,
l'atmosphère des scènes ou des paysages qu'il
voulait représenter.
La
caractéristique première de ses dessins est la
liberté du trait et le côté parfois totalement
imprévisible du tracé. Dans son documentaire
« Le mystère Picasso » (1956),
Henri-Georges Clouzot, essayait de répondre à la
question : que se passe-t-il dans le
cerveau d'un peintre lorsque celui-ci
travaille ? On peut retrouver la démarche
créative de Rembrandt en regardant comment ses
dessins préparatoires, parfois très
rudimentaires, lui permettaient quand il
s'estimait prêt, quelquefois après plusieurs
années de réflexion, de produire un chef-d'œuvre. Le résultat
final, techniquement insurpassable, a toute
l'apparence des plus grands tours de
magie : d'apparence facile mais
techniquement incompréhensible, c'est parfait
(voir par exemple la gravure : La
pièce de cent florins et ses études
préliminaires). On peut retrouver les différents
problèmes qu'il résolvait durant les différentes
étapes de son travail. Dans une première étape,
il analysait les problèmes de mouvement ou de
construction. Dans une seconde étape, lorsqu'il
avait compris les problèmes de mouvement et de
construction générale, il se concentrait sur
l'expression des personnages ou des animaux et
la reproduction de l'atmosphère de la scène
qu'il décrivait. Dans une troisième étape, il
plaçait les ombres et les lumières pour indiquer
les volumes et la hiérarchie des plans.
Rembrandt aimait également copier les maîtres
anciens.
Il faisait des croquis probablement tous les
jours. En quarante ans, sur la base de trois
croquis par jour, on peut penser qu'il a réalisé
un minimum de quarante mille croquis ou dessins.
Seuls, des paysages, des scènes de la Bible, des
scènes de la vie peuvent être des dessins très
achevés, mais très souvent ce sont des esquisses
intermédiaires, qui n'ont malheureusement pas
intéressé ses contemporains ou les collectionneurs
et l'énorme majorité de ses dessins préliminaires
a disparu.
Rembrandt avait beaucoup d'élèves qui ont dessiné
à sa manière, et comme la plupart des dessins
n'étaient ni datés ni signés, il peut être
extrêmement difficile de dater et d'attribuer avec
certitude les dessins de Rembrandt.
Après sa mise en faillite et la vente de sa
maison, de sa presse, de ses collections et de ses
biens en 1658, Rembrandt dut déménager en 1660 et
se concentra sur la peinture. Il nous reste
beaucoup moins de dessins correspondant à la
période 1660 – 1669.
La méthode d'étude de
Rembrandt
Lorsque Rembrandt observe
une scène quelques secondes ou imagine une scène,
il décompose les difficultés en plusieurs étapes
pour les comprendre.
Dans la première étape, Rembrandt analyse et
cherche à comprendre la construction et/ou le
mouvement de la scène. Mais il va dessiner la
scène de manière totalement différente s'il
observe une scène statique ou quasi-statique
(c'est-à-dire en mouvement lent) ou bien s'il
observe une scène en mouvement rapide (par exemple
des danseurs ou un homme montant à cheval). Dans
le cas d'une scène statique ou en mouvement lent,
le dessin de Rembrandt représente quasiment une
photo et correspond à un arrêt sur image du film
qu'il observe, alors que dans le cas d'une scène
en mouvement rapide, le dessin de Rembrandt
représente une superposition de photos du film qui
décrivent le mouvement rapide. Pour illustrer les
deux variantes de cette première étape nous
présenterons
deux dessins : le Couple
de mendiants avec un chien
et le Couple
de campagnards dansant.
Lorsque Rembrandt observe une scène dont une
partie est quasi-statique et une partie est en
mouvement rapide, il combine les deux variantes
dans le même dessin. C'est par exemple le cas dans
le dessin : Un homme aide un cavalier à
monter sur son cheval.
Dans la deuxième étape, Rembrandt cherche à
comprendre l'expression des personnages ou des
animaux de la scène. Pour illustrer cette
deuxième étape nous présenterons deux
dessins : Le
sacrifice de Manoach
et Soldats
faisant la bringue avec des femmes. Certaines études
combinent les deux méthodes de la première étape
ainsi que la seconde étape. Dans une partie du
dessin, Rembrandt étudie la composition de la
scène et dans une autre partie, il en analyse le
mouvement et enfin dans une troisième partie il
étudie l'expression des personnages ou des
animaux (voir le dessin Deux
chevaux dans un relais).
Dans la troisième étape, Rembrandt place les
ombres et les lumières pour indiquer la
hiérarchie des plans et traduire le volume de la
scène. Pour illustrer cette troisième étape nous
présenterons les dessins Le
soldat au bordel,
Le
vilain garçon,
la Jeune
femme allongée
et la gravure L'ange
quitte
Tobit et sa famille.
Ces études montrent l'extraordinaire faculté
qu'avait Rembrandt pour mémoriser, comprendre et
traduire les caractéristiques d'une scène qu'il
observait quelques secondes ainsi que ses facultés
exceptionnelles de dessinateur. Notons que lorsque
Rembrandt cherchait à comprendre un problème,
certains détails du dessin ne l'intéressaient pas
et il les traitait de manière bâclée ou
désinvolte, ce qui fit dire à des critiques que
Rembrandt ne savait pas dessiner !
Une grande caractéristique du travail de
Rembrandt est qu'il ne dessinait, ne gravait ou ne
peignait jamais deux fois de la même manière un
sujet donné. Pour garder la fraîcheur et la
spontanéité du dessin, Rembrandt changeait
notablement le dessin de la scène lorsqu'il
passait d'une étape à la suivante ou d'une
technique à une autre, dessin puis gravure, dessin
ou gravure puis peinture. Ce qui, de surcroît, lui
permettait d'étudier plusieurs manières de
représenter la scène tout en résolvant les
difficultés techniques qu'elle contenait. Cette
manière de faire lui permettait d'aborder un thème
donné pendant plusieurs décennies sans jamais se
répéter et elle montre les exceptionnelles
facultés d'imagination et de mémoire de Rembrandt.
Notons que ces facultés exceptionnelles
s'entretiennent et se travaillent. Citons
l'exemple de Katsushika Hokusaï qui décida de
dessiner un lion différent tous les jours et qui
en réalisa plusieurs centaines !
Première
étape
Lorsque
Rembrandt dessine des scènes correspondant à
la première étape, il réalise le dessin sur
place juste après avoir observé la scène
(observation qui dure une trentaine de
secondes au maximum).
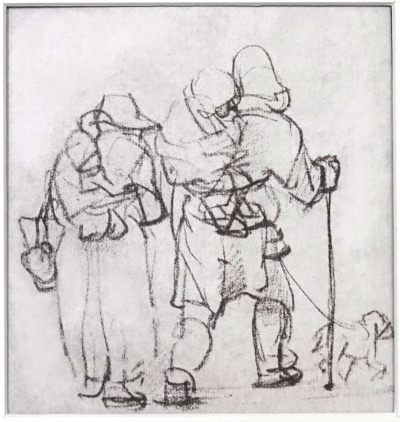
Couple de
mendiants avec un chien (circa
1647-48, Benesch, B 751, Schatborn & Hinterding,
D 390), {Albertina, Vienne}.
Le dessin Couple de mendiants avec un chien
illustre la manière dont Rembrandt étudie la
construction d'une scène éphémère
quasi-statique, c'est-à-dire en mouvement
lent. Les traits sont simples et délimitent
les formes des personnages et du chien sans
s'attarder sur les détails précis tels que
les mains ou les vêtements. Pourtant,
l'atmosphère de la scène est déjà
parfaitement traduite : on perçoit la marche
des personnages et le contraste entre
l'effort des parents et le sommeil paisible
des enfants portés sur leur dos. Ce croquis est un véritable arrêt sur
image du film que regarde Rembrandt,
témoignant de ses extraordinaires facultés à
mémoriser et analyser une scène observée en
quelques secondes. Il ne faut pas oublier que
Rembrandt dessinait quotidiennement, aussi
bien dans son atelier que lors de ses
promenades. Il croquait la vie où qu'il soit —
dans la rue, à la campagne, dans les tavernes
et tous les lieux où il pouvait observer la
réalité quotidienne.
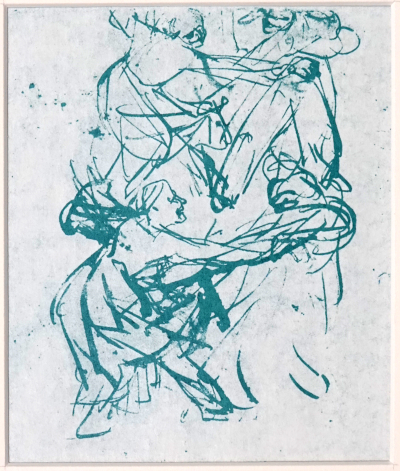
Couples
de campagnards dansant
(circa 1635, Benesch, B 258 verso), {Graphische
Sammlung, Munich}. Ce dessin
représente deux couples de campagnards
dansant lors d'une fête. Il illustre la
manière dont Rembrandt aborde le problème
du mouvement dans une scène éphémère et
rapide. Contrairement au traitement des
scènes quasi-statiques, ici, il cherche
avant tout à comprendre et à suggérer le
mouvement plutôt qu'à délimiter
précisément les formes des personnages.
Aucun détail n’est véritablement défini :
en quelques traits, il évoque le
déhanchement du danseur qui entraîne sa
partenaire, accentuant l'impression de
mouvement en dédoublant les bras des
danseurs et les jambes de la danseuse. Ce dessin donne l'illusion d'une
superposition d'images successives, comme
autant de clichés d'un film en mouvement
rapide (voir également les dessins Un
homme aide un cavalier à monter sur son
cheval
et Deux
chevaux au relais). L'impression de danse et de
dynamisme ressort puissamment de ce croquis
spontané, réalisé en quelques lignes.
Rembrandt ne cherche pas à représenter
précisément les danseurs, mais à suggérer leur
élan et leur vivacité. En guise de touche
finale, il dessine les visages des femmes,
exprimant clairement leur amusement, tandis
que la tête de l'homme est simplement
esquissée. Cette représentation des visages
féminins, témoignant de leur joie, correspond
à la seconde étape de sa méthode, dans
laquelle il s'attache à traduire l'émotion des
personnages.
Combinaison
des
deux variantes de la première étape
Lorsque Rembrandt observe une scène dont
une partie est quasi-statique et une
partie est en mouvement rapide, il combine
les deux variantes dans le même dessin.
Un homme aide un cavalier à
monter sur son cheval (circa
1637, Benesch, B 363 recto, circa
1640-41, Schatborn & Hinterding, D
48), {Rijksmuseum, Amsterdam}. Rembrandt
observe un homme aidant un cavalier à
monter à cheval. Ce dessin est un
parfait exemple de la manière dont
Rembrandt combine dans une même
composition une partie quasi-statique et
une partie en mouvement rapide. La
partie quasi-statique du dessin est
représentée par le cheval et l'homme
debout à ses côtés, dessinés de manière
simple et précise, comme un arrêt sur
image. Rembrandt esquisse l'arrière du
cheval et une patte, suggère la tête et
le cou, et dessine sommairement l'homme
qui aide le cavalier. Rembrandt dessine
le cavalier qui a le pied gauche dans
l'étrier et qui tient la selle avec la
main gauche, au moment où il enfourche
son cheval. La partie en mouvement
rapide correspond au cavalier qui
enfourche son cheval. Pour capturer
cette dynamique, Rembrandt utilise une
technique de superposition d'images,
dédoublant le bras droit et le buste, et
triplant la jambe droite du cavalier.
Cette approche rend parfaitement l'élan
et la difficulté de la montée à cheval,
créant une impression de mouvement en
quelques traits rapides et énergiques.
Au verso de cette feuille, Rembrandt a
dessiné Un cavalier avec un
carquois,
suggérant qu’il a rapidement enchaîné
les croquis, passant de l'étude
dynamique à une image plus posée.
Le croquis Un homme aide un cavalier à
monter sur son cheval
a également inspiré la représentation du cavalier
dans la peinture La concorde de l'État (1637 - 1645, Museum Boijmans, Rotterdam), montrant comment
Rembrandt réutilisait et adaptait ses
études graphiques dans d'autres œuvres.
 Le sacrifice de
Manoach (circa 1637-40, Benesch, B
180, circa 1635, Schatborn & Hinterding,
D 54), {Kupferstichkabinett, Berlin}.
Ce dessin est
l'une des plus belles représentations d'une
apparition et de l'envol d'un ange réalisées
par Rembrandt. Il illustre la scène biblique
où Manoach et sa femme, désespérés de ne pas
avoir d'enfant, sacrifient un agneau. Soudain,
un ange apparaît dans les flammes pour leur
annoncer la naissance de Samson, futur
libérateur d'Israël du joug des Philistins. Ce
croquis appartient à la deuxième étape de la
méthode de travail de Rembrandt, où il cherche
à exprimer l'émotion et la réaction des
personnages après avoir analysé et compris le
mouvement dans une étape précédente. Rembrandt
capte ici l'envol de l'ange, ainsi que le
recul de Manoach et de sa femme, témoignant de
leur surprise, de leur stupéfaction et de leur
peur. L'accent est mis sur le positionnement
des bras et des mains, ainsi que sur les
jambes de l'ange, pour intensifier la
sensation de mouvement et de légèreté.
Rembrandt ne s'attarde pas sur la précision
des détails comme les mains des personnages ou
les pieds de l'ange, ce qui lui a valu des
critiques injustifiées sur sa prétendue
incapacité à dessiner ces parties du corps.
Cependant, cette omission volontaire montre
bien que son objectif est ici de capturer
l'essence et l'émotion de la scène plutôt que
d'en détailler chaque élément. La liberté du
trait et le caractère imprévisible du tracé
traduisent parfaitement le caractère éphémère
et spirituel de cette apparition. Rembrandt
porte une attention particulière à
l'expression du visage de Manoach, moins
marquée pour celui de sa femme, montrant ainsi
où se concentre son intérêt dans cette étude.
Ce dessin incarne la manière de Rembrandt
d'équilibrer spontanéité et maîtrise technique
pour rendre l'instantanéité et l'impact
émotionnel d'une scène. Ce croquis a servi de
source d'inspiration pour d'autres œuvres de
Rembrandt, notamment la peinture L'ange
quitte Tobit et sa famille (1637) et la gravure L'ange
quitte Tobit et sa famille (1641).
Le traitement de l'ange dans ces œuvres montre
comment Rembrandt approfondit et enrichit
progressivement sa compréhension du mouvement
et de l'expression, passant de l'étude
préliminaire à l'œuvre achevée.

Trois
soldats faisant la bringue avec des
femmes
(circa 1635, Benesch, B 100 verso,
Schatborn & Hinterding,
D 31), {Kupferstichkabinett, Berlin}. Ce dessin a
été réalisé à la même période que Couple
de campagnards dansant. Il
correspond à la deuxième étape de
l'évolution artistique de Rembrandt.
L'artiste a résolu le problème de la
construction des couples et s'intéresse
désormais principalement à l'expression
des personnages. Le soldat du premier couple tente de
glisser sa main entre les cuisses de la femme,
qui réagit violemment : elle essaie de lui
retirer la main et s'apprête à le gifler.
Rembrandt dédouble le bras droit de la femme
pour suggérer le mouvement, tout en
privilégiant l'expression de son visage. Dans
le cas du deuxième couple, l'artiste montre
des personnages qui s'amusent en échangeant
des caresses.
Combinaison des étapes 1
& 2

Deux
chevaux au relais ou à la ferme (circa 1637,
Benesch, B 461, circa 1629, Schatborn & Hinterding,
D 460), {Rijksmuseum, Amsterdam}. Deux chevaux
tirant une carriole arrivent pour se
reposer. Le conducteur place une
couverture sur les chevaux tandis qu'une
femme donne un fruit à manger à l'un
d'eux. Cette
étude est particulièrement remarquable car
elle combine les deux méthodes
caractéristiques de la première étape et la
seconde étape de la technique d'étude de
Rembrandt pour représenter une scène éphémère.
Dans un premier temps, Rembrandt réalise la
partie quasi-statique, ou "arrêt sur image",
qui lui permet de structurer son dessin. Cette
première étape comprend la carriole, le
cocher, la couverture et la femme, représentés
de manière très simple et sans aucun détail.
Au second plan, il dessine ensuite la tête du
cheval en train de manger le fruit offert par
la femme, correspondant à l'étude du mouvement
de la première étape. Pour suggérer le
mouvement, Rembrandt dédouble et même triple
le tracé de la tête du cheval, montrant ainsi
l'animal attrapant le fruit et commençant à le
mâcher. Il s'agit là d'un exemple de repentir
utilisé pour exprimer le mouvement, une
technique également observable dans les
dessins Couple
de campagnards dansant et Un
homme aide un cavalier à monter
sur son cheval. Le dédoublement pour indiquer le
mouvement était déjà employé à l'époque
paléolithique et néolithique (par exemple dans
l'art de l'Égypte ancienne). Enfin, Rembrandt
traite en détail l'expression de la tête du
cheval au premier plan, ainsi que son encolure
et ses quatre pattes, ce qui correspond à la
seconde étape de sa méthode d'étude. Il
convient de souligner, une fois de plus, les
extraordinaires facultés de mémorisation et
d'analyse de Rembrandt, qui parvient à
capturer en quelques secondes une scène
éphémère avec une telle précision.
Troisième
étape

Le vilain
garçon (circa 1635, Benesch, B
401, Schatborn &
Hinterding,
D 238), {Kupferstichkabinett, Berlin}.
Ce dessin correspond à la troisième
étape de l'évolution artistique de
Rembrandt. L'artiste a résolu les
problèmes de construction, de
mouvement et d'expression des
personnages. Il utilise les ombres et
les lumières pour créer une impression
de volume. Pour renforcer le
caractère violent et éphémère de la
scène, Rembrandt représente la chaussure
de l'enfant qui vient de se détacher de
son pied et qui est en train de tomber.
Bien qu'il porte une grande attention au
mouvement des deux femmes et de
l'enfant, ainsi qu'à l'expression des
visages des femmes et des trois enfants,
il esquisse très succinctement les mains
des femmes et surtout leurs pieds.
Rembrandt concentre ainsi son travail
sur la partie du dessin destinée à
capter l'attention du spectateur et à
exprimer le caractère dramatique de la
scène.

Le soldat au bordel ou Le
soldat à la taverne
(circa 1642-43, Benesch, B 529),
{collection privée}. Ce dessin est également
appelé Le fils prodigue en
compagnie des femmes légères ou Le fils prodigue
à la taverne. Cependant,
l'homme porte une dague à
sa ceinture et son épée
est posée le long du
fauteuil, à droite du
dessin, ce qui rend peu
probable l'identification
avec le fils prodigue. Ce dessin illustre
la troisième étape de la
méthode de Rembrandt et se
présente comme un tableau
miniature. On remarque la
liberté du trait et la
simplicité des décors, car
ce qui intéresse l'artiste,
c'est avant tout de recréer
l'atmosphère et l'expression
des personnages en train de
s'amuser.

L'ange
quitte Tobit et sa famille
(1641), {Rijksmuseum,
Amsterdam}.
L'archange Raphaël quitte
Tobit et sa famille après
avoir guéri la cécité du
père de Tobit. La famille
remercie l'ange, qui
s'envole et disparaît. Dans cette gravure très
aboutie, Rembrandt reprend
l'étude de l'ange du dessin Le
sacrifice de
Manoach. Cette gravure
correspond à la troisième étape
de son évolution artistique et
constitue une variante de la
peinture de 1637 intitulée L'ange
quitte Tobit
et sa famille. L'une des
particularités de Rembrandt est
sa capacité à s'intéresser à un
même sujet pendant plusieurs
années, en proposant des
représentations très
différentes. Dans cette gravure,
il se concentre sur la famille
de Tobit et l'expression des
personnages. Notons que pour
Rembrandt, le petit chien
symbolise la loyauté de la
famille envers l'archange
Raphaël, alors que, dans la
Bible, le chien est perçu comme
un animal néfaste et mal réputé.
Cela démontre que lorsqu'il
dessine une scène biblique,
Rembrandt y imprime sa
personnalité et fait toujours
prévaloir son point de vue sur
les conventions généralement
admises. Rembrandt ne représente
que la partie inférieure de
l'ange en plein envol, suggérant
ainsi sa disparition rapide aux
yeux de la famille de Tobit et
du spectateur, témoins d'une
scène éphémère. Même l'âne
semble estomaqué par l'envol de
l'ange, renforçant l'effet de
surprise et de stupeur.
Jeune
femme allongée,
probablement Hendrickje
Stoffels (circa 1655-56,
Benesch, B 1103, circa 1654,
Schatborn
&
Hinterding,
D 441), {British Museum,
Londres}. Ce dessin est
réalisé au pinceau et à
l'encre et est l'un des
chefs-d'œuvre
de Rembrandt. Il permet de
se rendre compte de ce que
Rembrandt pouvait réaliser
lorsqu'il avait fini de
résoudre les difficultés
préliminaires. On peut
pratiquement retrouver
l'ordre des coups de pinceau
en fonction de la charge
d'encre qui reste dans le
pinceau.
Garder
la construction la plus
ouverte possible
La passion de Rembrandt
pour la liberté a
fortement influencé sa
manière de dessiner.
L'une des
caractéristiques de son
trait est en effet la
liberté de son tracé,
parfois imprévisible.
Pour préserver cette
spontanéité, Rembrandt
s'efforce de maintenir
la construction de son
dessin aussi ouverte que
possible. On parle de
"fermer" la construction
d'un dessin lorsque les
premiers traits posés
contraignent la suite de
l'élaboration. Par exemple,
on peut esquisser une tête
par un ovale pour une
construction rapide en phase
préliminaire, mais il ne
faut pas commencer par un
ovale si l'on souhaite
réaliser un portrait
détaillé. De même, lorsqu'on
dessine une scène avec
plusieurs personnages, il
est préférable de placer
d'abord les personnages
avant d'ajouter le décor en
arrière-plan. Pour conserver
la liberté du trait, il est
essentiel de retarder au
maximum l'introduction des
contraintes lors de
l'élaboration du dessin.
Pour illustrer ce principe,
nous présenterons une étude
préparatoire pour la
peinture Saint
Jean-Baptiste prêchant. Nous montrerons
comment Rembrandt procède
lorsqu'il focalise son
intérêt sur un personnage
particulier au sein d'un
groupe.
 Etude
préliminaire (circa
1637, Benesch, B139A),
{Collection privée} pour
le tableau Saint
Jean-Baptiste prêchant. À cette étape du
travail, Rembrandt dessine
les têtes sous forme
d’ovales, car il ne
cherche pas encore à en
représenter les détails ni
à réaliser des portraits.
Il place d'abord les
personnages ou les groupes
de personnages, puis
positionne les éléments du
décor. Ce dessin
correspond à la première
étape d'étude de
Rembrandt. En bas du tableau,
à droite, il suggère la
présence d'une femme assise
avec un enfant sur ses
genoux, pour lesquels il
réalisera par la suite
plusieurs études. Nous
présenterons deux de ces
études: Etudes
de femme
assise.
Lorsqu'il focalise
son intérêt sur un
personnage
particulier au sein
d'un groupe, il est
très intéressant
d'observer comment
Rembrandt dessine ce
groupe tout en
évitant de fermer la
construction de son
dessin. Nous
présenterons les deux
dessins Guidé par un
ange, Loth et sa
famille quittent
Sodome et Loth et ses
filles, dans lesquels
Rembrandt se concentre
sur les personnages
principaux, en
particulier sur celui de
Loth. Dans les deux
œuvres, il met
habilement en valeur les
figures principales tout
en permettant aux
éléments environnants de
rester plus vaguement
définis, créant ainsi
une composition
dynamique et ouverte.
Cette approche met en
avant les personnages
centraux sans limiter la
fluidité de la scène,
ajoutant un sentiment de
mouvement et de
spontanéité aux dessins.
Guidés par
un ange, Loth
et sa famille
quittent
Sodome
(circa 1636,
Benesch B
129),
{Albertina,
Vienne}.
Guidés
par
un ange, Loth,
sa femme et
ses filles
quittent
Sodome, vouée
à la
destruction
par Dieu.
L'ange les
avertit de ne
pas se
retourner ;
cependant, la
femme de Loth,
qui bravera
cet
avertissement
pour regarder
en arrière,
sera
transformée en
statue de sel.
Loth et ses
filles se
réfugieront
ensuite dans
une grotte
(voir le
dessin suivant
Loth
et ses filles).
Pour
préserver
l'ouverture de
sa
composition,
Rembrandt
commence par
dessiner le
personnage de
Loth, très
abouti avec
des ombres
marquant les
volumes.
Ensuite, il
représente
l'ange et la
femme de Loth
qui
l'entourent et
le guident,
pour
finalement
esquisser de
manière
succincte les
deux filles
qui les
suivent. Ce
dessin
constitue un
excellent
exemple de
feuille
d'étude,
révélant les
trois étapes
caractéristiques
du travail de
Rembrandt. Un
autre point
intéressant
est la
question de
l'attribution
de ce dessin.
En effet, au
verso de la
feuille se
trouve un
dessin réalisé
probablement
une dizaine
d'années
auparavant par
un élève de
Lastman. Cela
a conduit
certains
experts à
émettre
l'hypothèse
que ce dessin
pourrait ne
pas être de
Rembrandt
lui-même, mais
plutôt une
copie réalisée
par Govert
Flinck (?) ou
Jan Victors
(?) dans les
années
1640-45. La
légende
raconte que
lorsque
Rembrandt prit
cette feuille
pour dessiner,
un de ses
élèves lui dit
: « Non
Maître, ne
prenez pas
cette feuille
pour dessiner,
sinon dans
trois cents
ans, des
experts
pourraient
déclasser
votre dessin !
». Rembrandt
haussa les
épaules et
réalisa tout
de même son
dessin.

Loth
et ses filles
(circa 1636, Benesch, B
128, circa 1638,
Schatborn
&
Hinterding,
D 57), {Klassik
Stiftung, Weimar}. Après avoir
quitté Sodome, détruite
par Dieu, Loth et ses
filles se réfugient dans
une grotte où se trouve du
vin, placé là par la
volonté divine. Les deux
filles se retrouvent
seules avec leur père, car
leurs fiancés ont refusé
de les suivre. Craignant
de ne pas avoir de
descendance dans ce lieu
isolé, l’aînée décide
d'enivrer son père afin
qu'il la rende enceinte et
convainc sa sœur cadette
de faire de même. De cette
relation incestueuse
naîtront deux fils : Moab,
fondateur du royaume des
Moabites, et Ben-Ammi,
fondateur du royaume des
Ammonites. Le dessin
représente la fille aînée
incitant son père à boire
en lui tendant la coupe,
tandis que Loth, déjà
enivré, commence à
vaciller. Pour préserver
l'ouverture de sa
composition, Rembrandt
commence par dessiner Loth
de manière très aboutie, à
l'exception de ses jambes,
esquissées de façon plus
succincte. Ensuite, il
dessine le visage
expressif et la main de la
fille aînée qui pousse son
père à continuer de boire.
Enfin, il esquisse la
silhouette de la fille
cadette et ajoute quelques
éléments de décor. Ce
dessin est un magnifique
exemple de feuille d'étude
montrant les trois étapes
caractéristiques du
travail de Rembrandt. Il
fut précédé d'un dessin
plus abouti, Loth
et ses filles (circa 1631),
généralement attribué à
l'école de Rembrandt mais
peut-être de sa main, et
popularisé par la gravure
de Jan van
Vliet
en 1631.
Un
trait parfois
totalement
imprévisible
Enfin, remarquons
que le dessin de
Rembrandt se
distingue également
par un trait au
tracé totalement
imprévisible d'une
virtuosité
remarquable (voir
par exemple Le
sacrice
de Manoach).
Grâce à ce procédé,
Rembrandt suggère ce
qu'il souhaite
représenter sans en
dessiner précisément
les contours.Rembrandt
utilise généralement
cette technique en fin
de réalisation d'un
dessin, afin de
préserver la fraîcheur
et la vitalité qui en
émanent, évitant toute
raideur ou rigidité.
Un exemple frappant de
cette approche se
trouve dans le
portrait de Saskia de
1633.

Portrait de
Saskia (détail
du dessin daté de
1633 et annoté par
Rembrandt, Benesch B
427, Schatborn
&
Hinterding,
D 629),
{Kupferstichkabinett,
Berlin}.
Rembrandt
réalise le portrait
de Saskia le 8 juin
1633, trois jours
après leurs
fiançailles. Ce
dessin, exécuté à la
pointe d'argent sur
parchemin, commence
par la
représentation du
visage, du chapeau
et de la main gauche
de Saskia, suivie de
la main droite. Il
est intéressant de
noter que cette main
droite manque de la
finesse de l'autre et
ressemble davantage à
une main d'homme. Il
pourrait s'agir de la
main de Rembrandt
lui-même, offrant une
fleur à sa fiancée
bien-aimée. Ensuite,
il achève les deux
manches et l'épaule de
l'habit de Saskia par
un tracé aux lignes
totalement
imprévisibles. Ce
trait virtuose suggère
l'épaule et les
manches sans en
dessiner explicitement
les contours,
produisant un résultat
bien plus élégant que
si les manches avaient
été dessinées de
manière
conventionnelle. Cette
manière de dessiner
sans fermer la
construction est
caractéristique de la
période heureuse de la
vie de Rembrandt, où
la spontanéité et la
liberté du trait
traduisent son état
d'esprit.
Attirer
le regard du
spectateur
Pour Rembrandt,
l'important n'est
pas simplement de
dessiner l'ensemble,
mais de se
concentrer sur la
partie du dessin qui
l'intéresse et qui
lui permet
d'exprimer ce qu'il
souhaite. C'est
cette partie qui
doit capter le
regard de
l'observateur (voir
par exemple : Trois
soldats faisant la
bringue avec des
femmes, Les
chevaux au relais, Le vilain
garçon, Accompagné
d'un ange, Loth
quitte Sodome avec
sa famille, Portrait
de Saskia). Cette
manière de traiter
le sujet se retrouve
dans certaines
peintures exécutées
après 1650. Il
convient également
de noter que, dans
le traitement du
sujet dans un dessin
ou une gravure, le
thème devient
secondaire par
rapport à la vie
qu'il insuffle dans
ses œuvres (par
exemple : Omval). Pour
compléter notre
propos, nous
présenterons aussi
la peinture Femme se
baignant dans un
ruisseau et les
études de femme
assise de
Rembrandt, ainsi que
la lithographie La mère
et son enfant de Käthe
Kollwitz et
l'estampe La grande
vague de Kanagawa de
Katsushika Hokusai.
Femme se
baignant dans
un ruisseau
(1654),
{National
Gallery,
Londres}. Dans
cette
peinture,
Rembrandt se
concentre sur
le visage de
la femme
entrant dans
l'eau,
exprimant
ainsi le
plaisir
qu'elle
ressent à
l'idée de se
baigner. Il
porte
également une
attention
particulière
aux
vaguelettes
provoquées par
les jambes de
la femme dans
l'eau du
ruisseau,
suggérant le
mouvement de
son entrée
dans l'eau. Le
visage et les
ondulations de
l'eau sont les
seules parties
du tableau
traitées avec
une grande
délicatesse et
une finition
minutieuse. En
revanche, la
robe est
peinte avec
une grande
virtuosité, à
grands coups
de pinceau et
avec beaucoup
d'empâtement.
La main droite
de la femme,
qui relève la
robe, est
esquissée de
manière
succincte,
mais cette
simplification
ne choque pas
si l'on ne
s'attarde pas
sur les
détails. Cette
manière de
peindre était
totalement
incomprise par
les
contemporains
de Rembrandt,
qui lui
reprochaient
de réaliser
des œuvres
inachevées.
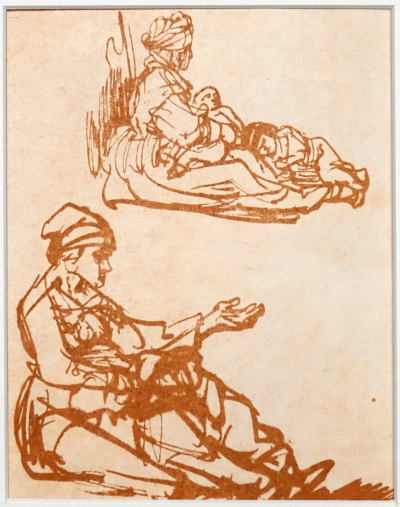
Etudes de
femme assise
(circa 1633,
Benesch, B179,
circa 1639,
Schatborn
&
Hinterding,
D 343), {Musée
du Louvre,
Paris},
utilisée dans
le tableau Saint
Jean-Baptiste
prêchant
.
Rembrandt
lorsqu'il
dessine le
portrait de la
femme assise,
en bas de la
feuille, ne
dessine pas
son visage par
un ovale car
il cherche à
étudier son
expression,
alors qu'il le
fait pour la
femme assise
en haut car il
ne cherche pas
à détailler
son visage et
à étudier son
expression.
Comme
Rembrandt veut
avoir un trait
le plus
continu
possible (il
ne veut pas
dessiner des
fragments de
traits les uns
derrière les
autres), il
lui est
souvent très
difficile de
bien dessiner
par exemple
les mains.
Dans le cas de
l'étude de la
femme du bas,
Rembrandt se
concentre sur
l'expression
de son visage
et sa main
gauche. Notons
que si sa main
gauche n'est
pas très bien
dessinée, elle
traduit
parfaitement à
elle seule le
fait que la
femme est une
pauvre femme
qui quémande
de l'argent ou
de la
nourriture.
Dans l'étude
du haut,
Rembrandt se
concentre sur
la
représentation
des deux
enfants de
manière
beaucoup plus
précise que
dans l'étude
du bas. Ces
deux études de
femme assise
ont été
suivies par
une troisième
étude
différente et
on remarquera
que les trois
études sont
différentes de
la version
finale peinte.
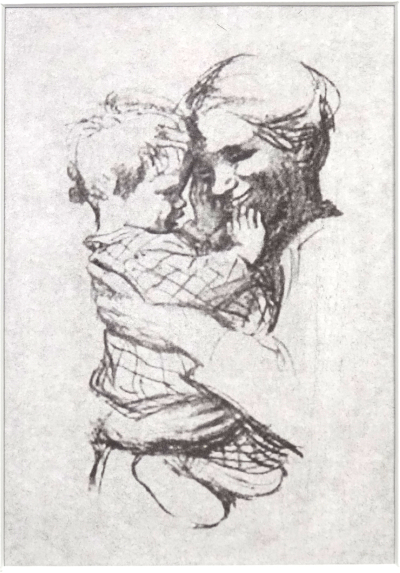
La
Mère
et son Enfant
(1916,
lithographie) de
Käthe Kollwitz est
une œuvre
poignante et
émotive,
caractéristique du
style
expressionniste de
l'artiste.
Kollwitz, connue
pour ses œuvres
sociales et
humanistes,
explore souvent
des thèmes tels
que la souffrance,
l'amour et la
lutte des classes.
Dans cette
lithographie, elle
dessine avec précision
les visages de la
mère et de
l'enfant, ainsi
que les deux mains
de ce dernier.
Elle met en
lumière
l'intensité de
l'amour maternel à
travers
l'expression
profonde et
sensible des
visages. Les
regards des deux
figures, la mère
et l'enfant, sont
au centre de
l'attention. C’est
à travers ces
regards que
l'artiste
communique les
émotions et la
relation intime
qui les unit. La
mère contemple son
enfant avec un
amour
incommensurable et
une tendresse
palpable, tandis
que l'enfant
paraît à la fois
dépendant et
confiant, en
sécurité dans
l'étreinte
maternelle.
L'absence de
détails précis
dans le dessin des
mains de la mère
renforce l'idée
que ce n'est pas
la technique qui
est au cœur de
l'œuvre, mais
l'expression pure
des sentiments.
Cette inexactitude
volontaire peut
être perçue comme
une simplification
destinée à
permettre au
spectateur de se
concentrer sur
l'émotion brute,
sans distraction.
La représentation
de la mère et de
l'enfant,
dépourvue
d'artifice ou
d'embellissement,
confère à l'œuvre
une sincérité et
une universalité
qui transcendent
la technique pour
toucher
directement l'âme
du spectateur.

La
Grande
Vague de
Kanagawa,
estampe de
Katsushika Hokusai
(1831), fait
partie de la
célèbre série Trente-six
vues du Mont
Fuji (Fugaku
sanjūrokkei).
Comme pour
Rembrandt dans le
cas de la gravure
Omval, le
Mont Fuji devient
secondaire ; ce
qui intéresse
Hokusai, c’est
avant tout la
condition de vie
des pêcheurs. Il
représente une
immense vague
déferlante au
large de la baie
de Kanagawa, avec,
en arrière-plan,
le Mont Fuji. Il
est intéressant de
noter que, bien
que le Mont Fuji
soit un symbole
sacré du Japon,
Hokusai met
l'accent sur les
pêcheurs, dont les
frêles
embarcations
luttent contre
l'immensité de la
mer et la
puissance de la
vague. Cela
reflète une forme
d'humanisme, où
les conditions de
vie difficiles des
pêcheurs, issus de
classes sociales
modestes, sont
magnifiées au même
titre que le Mont
Fuji, sacré mais
lointain. En
représentant la
lutte des pêcheurs
contre les forces
de la nature,
Hokusai élève ces
figures populaires
à un rang presque
mythologique, leur
conférant une
dignité
remarquable par la
puissance de sa
représentation.
Par son mouvement
dynamique et sa
profondeur, la
composition de
Hokusai est un
chef-d'œuvre de
l'art japonais de
l'époque Edo. La
grande vague, avec
son énergie
vibrante et sa
forme abstraite,
est devenue l'une
des images les
plus
reconnaissables de
l'art japonais et
de la gravure sur
bois.
Pour illustrer
l'ensemble de
ce que nous
venons de
développer,
nous
présentons l'
Etude
pour
la lamentation
de Jacob.
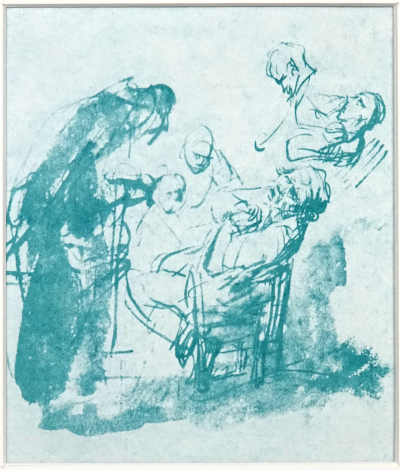
Etude pour
la lamentation
de Jacob
(circa 1635,
Benesch, B 95,
Schatborn
&
Hinterding,
D 40),
{Kupferstichkabinett,
Berlin}.
Ce dessin
incarne
parfaitement
la démarche
artistique de
Rembrandt et
illustre les
principes que
nous avons
précédemment
développés.
Jacob,
petit-fils
d'Abraham, a eu
douze fils qui
fonderont les
douze tribus
d'Israël. Il
se lamente car
le Seigneur a
détruit toutes
ses demeures.
Il est représenté
dans une
posture de
lamentation
intense,
suppliant un
spectre qui
apparaît dans
sa détresse.
Convaincu
qu'il s'agit
d'une vision
de Dieu, Jacob
est en réalité
confronté au
spectre de son
frère jumeau,
Esaü. La
vision du
spectre de
Dieu aurait
provoqué sa
mort, Jacob
est connu pour
être le père
de Joseph,
lequel fut
accusé à tort
par la femme
de Potifar
d'avoir tenté
de la séduire.
À travers
cette étude,
on retrouve
l'exceptionnelle
maîtrise du
trait propre à
Rembrandt :
une liberté
d'exécution
qui préserve
la fraîcheur
du dessin tout
en conservant
une puissance
émotionnelle
remarquable.
Les contours
demeurent
ouverts, ce
qui permet de
suggérer les
formes sans
les figer,
renforçant
l'impression
de mouvement
et de
spontanéité.
Le tracé est à
la fois
dynamique et
subtil,
permettant de
faire émerger
les émotions
de manière
presque
instinctive.
Cette
virtuosité
contribue à
l'humanité qui
se dégage de
l'œuvre,
témoin de la
profondeur
artistique de
Rembrandt.
L'évolution
du trait de
Rembrandt
Comme indiqué
précédemment,
l'utilisation d'un
trait au tracé
totalement
imprévisible est
caractéristique de
la période heureuse
de la vie de
Rembrandt. Son style
évolua
considérablement
vers la fin de sa
vie, notamment après
1655. Après son
déménagement en
1660, alors que sa
presse avait été
saisie, Rembrandt
produisit très peu
de gravures. Il est
également possible
que sa production de
dessins ait diminué,
d'autant plus qu'il
nous reste peu de
dessins
correspondant à
cette période. Cette
évolution
stylistique
s'accentua après la
mort d'Hendrickje
Stoffels en 1663. Pour
illustrer cette
évolution du trait de
Rembrandt, nous
présenterons le dessin
Diane
et Actéon.

Diane et
Actéon,
(circa 1662-65,
Benesch – B
1210, circa
1656, Schatborn
&
Hinterding,
D 161),
{Kupferstichkabinett,
Dresde},
est probablement
l'un des
derniers dessins
connus de
Rembrandt. Dans
sa période
tardive, il
aborde une
nouvelle fois ce
thème, en
réalisant une
transposition
libre d'une
gravure
d'Antonio
Tempesta
(1555-1630). Bien
que le dessin
conserve une
grande liberté
d'exécution, il se
simplifie
considérablement :
les courbes sont
souvent remplacées
par des lignes
droites, et le
trait devient plus
raide, anguleux et
rudimentaire.
Rembrandt utilise
plus volontiers le
roseau ou le
bambou, qui
permettent
d'obtenir un tracé
à la fois
vigoureux et très
nuancé. On
remarque
l'extraordinaire
efficacité avec
laquelle il
représente les
têtes et les
visages de Diane
et de ses
suivantes. Après
la mort
d'Hendrickje
Stoffels et toutes
les épreuves qu'il
avait traversées,
Rembrandt,
désormais au-delà
de la douleur,
cherche à éviter
tout superflu
brillant,
privilégiant la
simplicité et
l'essentiel. Les
traits au tracé
imprévisible, si
caractéristiques
de ses périodes
antérieures,
disparaissent de
ses dessins
tardifs. Cette
évolution
stylistique fut
peut-être
amplifiée par des
problèmes de santé
ou de vision, et
elle se manifeste
également dans ses
peintures.
Cependant, ce
style dérouta ses
admirateurs, qui
considéraient
alors ses œuvres
comme inachevées
et ne désiraient
plus les acheter.
Pourtant,
Rembrandt, détaché
de l'avis de ses
clients
potentiels,
poursuivait sa
quête artistique
personnelle.
La
perception et la
représentation du
volume par Rembrandt
Comme nous l'avons
indiqué
précédemment,
Rembrandt ne
dessinait jamais
deux fois les scènes
qu'il étudiait de la
même manière. La
version finale de la
scène qu'il
souhaitait
représenter était
toujours différente
des études
préparatoires qu'il
avait réalisées.
Cette méthode de
travail lui
permettait
d'appréhender le
sujet ou la scène en
volume, renforçant
ainsi la
compréhension
spatiale de son
motif. Arnold
Houbraken (1660–1719)
rapporte à ce propos :
«
Il lui arrivait
fréquemment
d'esquisser un
visage de dix
manières avant de le
reproduire sur la
toile ». En tant que
dessinateur, graveur
et peintre, Rembrandt
a toujours cherché à
restituer le volume de
la scène représentée,
de manière à donner au
spectateur
l'impression
d'observer non pas une
image figée et
projetée en deux
dimensions, mais une
scène vivante,
naturelle et donc plus
humaine. Très tôt, il
comprit que l'un des
moyens de résoudre ce
problème était
l'utilisation du
clair-obscur et, plus
largement, du jeu des
ombres et des
lumières. Cela
apparaît déjà
clairement dans la
peinture La parabole
du riche idiot
(Gemäldegalerie,
Berlin), réalisée en
1627, soit trois ans
après la création de
son atelier à Leyde.
Pour accentuer l'effet
de volume dans ses
peintures, Rembrandt
représente très
souvent les
arrière-plans de
manière floue,
renforçant ainsi
l'illusion de
profondeur.

Le portrait de Jan
Cornelis Sylvius est
l'exemple le plus
extraordinaire des
recherches de
Rembrandt en gravure
visant à donner au
spectateur une
impression de volume,
de vie et de naturel.

Portrait
de Jan Cornelis
Sylvius,
Rembrandt (1646)
{Rijksmuseum,
Amsterdam}.
Pour accentuer
l'impression de
volume, Rembrandt
impose au spectateur
un angle de vision
précis en dessinant
la perspective de la
coupe (ou du biseau)
du passe-partout.
Ainsi, le spectateur
se trouve légèrement
en contrebas, sur la
droite par rapport à
Jan Cornelis. La
lumière, quant à
elle, provient
également de la
droite, mais d'une
source placée plus
haut que le modèle.
Afin de
renforcer l'effet de
relief, Rembrandt fait
littéralement sortir du
plan de l'image la main
droite, le livre et la
tête de Jan Cornelis, en
projetant leurs ombres
sur le passe-partout. Ce
procédé confère au
portrait une impression
saisissante de vie et
d'humanité. Rembrandt
parvient ainsi à
transcender l'anecdote
pour créer une œuvre qui
dépasse la simple
projection sur la
feuille de papier.
Les
catalogues des
dessins de
Rembrandt
(Un
exemple de
problème
d'attribution)
Les deux
catalogues les
plus complets des
dessins de
Rembrandt sont le
catalogue d'Otto
Benesch (The
Drawings of
Rembrandt,
1973), en six
volumes, et le
catalogue de Peter
Schatborn et Erik
Hinterding (Rembrandt,
tous les dessins
et toutes les
eaux-fortes,
2019). Il existe
également de
nombreux autres
catalogues, plus
partiels, que nous
ne citerons pas
ici.
Comme indiqué
précédemment, la
plupart des
dessins de
Rembrandt ou de
son cercle
d'élèves n'étaient
généralement ni
datés ni signés,
ce qui rend leur
datation et leur
attribution
extrêmement
difficiles à
établir avec
certitude.
Le catalogue de
Benesch (1973)
fournit pour
chaque dessin une
description, un
historique, ainsi
que les raisons de
l'attribution à
Rembrandt. Le
catalogue de
Schatborn et
Hinterding (2019)
est une révision
et une mise à jour
de celui de
Benesch (1976),
utilisant les
critères expliqués
dans Schatborn
& van Sloten
(2014). Ce dernier
est destiné à un
large public et ne
contient ni
description, ni
historique, ni
explication des
raisons de
l'attribution à
Rembrandt pour
chaque dessin.
Le principal
problème des
catalogues de
Schatborn (1985)
et de Schatborn
& Hinterding
(2019), basés
sur les critères
de Schatborn
& van Sloten
(2014), est
qu'ils ne
tiennent pas
compte de deux
caractéristiques
fondamentales de
la manière de
dessiner de
Rembrandt. La première
caractéristique
concerne la manière
dont Rembrandt
aborde un sujet :
lorsqu'il découvre
un sujet, il
commence par en
étudier les
proportions et le
mouvement. Si le
sujet est en
mouvement lent, il
réalise un "arrêt
sur image" (par
exemple, Couple
de mendiants
avec un chien). Mais si
le sujet est en
mouvement rapide, il
opte pour une
superposition
d'images qui
décrivent le
mouvement (par
exemple, Couple
de campagnards
dansant, Un
homme aide un
cavalier à
monter sur son
cheval, Trois
soldats
faisant la
bringue avec
des femmes, Deux
chevaux au
relais ou à la
ferme,
Le
cheval
qui mange un
fruit dans la
main de la
femme). La
seconde
caractéristique
négligée est que
Rembrandt ne
dessinait jamais
un même sujet de
la même manière
deux fois de
suite. Autrement
dit, il ne copiait
jamais un dessin
ou une gravure, ce
qui lui permettait
de maintenir une
grande spontanéité
et une fraîcheur
du trait, que ce
soit dans ses
dessins, ses
gravures ou ses
peintures.
Il est très
intéressant
d'observer
comment ces
deux lacunes
peuvent
influencer les
conclusions et
les
déductions, en
prenant
l'exemple du
dessin Un
homme
aide un
cavalier à
monter sur son
cheval.
Ce dessin
combine les
deux méthodes
de la première
étape : il
présente un
"arrêt sur
image" pour la
partie quasi
statique, avec
le cheval et
l'homme aidant
le cavalier,
et une
superposition
d'images qui
décrit le
mouvement du
cavalier
enjambant la
selle pour
monter sur le
cheval (voir
page 19). Sur le
verso, Rembrandt a
dessiné un cavalier
avec un carquois,
suggérant
qu'immédiatement
après avoir
réalisé cette
étude, il tourna
la feuille et
dessina un
cavalier coiffé
d'un chapeau à
plumes, sur son
cheval.
Cavalier avec
un carquois,
(circa
1662-65,
Benesch – B
1210), {Rijksmuseum,
Amsterdam}.
Ce
croquis sera
plus tard
utilisé par
Rembrandt dans
la gravure Le
baptême de
l'eunuque
(1641).


Pour préserver
la fraîcheur
et la
spontanéité du
trait,
Rembrandt
grava une
variante du
croquis Un
cavalier avec
un carquois,
sans inverser
le dessin.
C'est la
méthode de
travail
typique de
Rembrandt.
Concernant le
dessin Un
homme
aide un
cavalier à
monter sur son
cheval,
Schatborn
(1985, page
46) n'écrit
pas : « Rembrandt
a
réalisé une
très belle
étude de
mouvement d'un
cavalier
montant à
cheval
», mais il
conclut plutôt
que « Rembrandt
a
essayé de
dessiner un
cavalier
montant à
cheval, mais
il ne semble
pas avoir
trouvé une
solution...
». Il est
intéressant
d'analyser les
conséquences
de cette
incompréhension
initiale. En
effet,
Schatborn en
déduit que « Ceci
montre
que Rembrandt
n'a pas
dessiné
d'après le
modèle mais a
travaillé de
mémoire...
» et pour
expliquer le
dessin du
cavalier sur
le verso de la
feuille, il
affirme : « Le
dessin
fait au verso
n'est pas de
Rembrandt,
mais a été
ajouté par un
marchand pour
rendre le
croquis du
cavalier
montant à
cheval plus
attrayant pour
le vendre !
» Donc, Schatborn
(1985)
n'attribue pas
le dessin Un
cavalier avec
un carquois à
Rembrandt, et ce
croquis ne
figure pas dans
le catalogue des
dessins de
Rembrandt de
Schatborn et
Hinterding
(2019). La
légende raconte
qu'après avoir
fini ces
croquis,
Rembrandt se
rendit dans une
taverne avec
l'un de ses
élèves. Ce
dernier, après
avoir observé
les croquis, dit
à Rembrandt : «
Maître,
vous devriez
expliquer vos
croquis et
votre méthode
de travail,
car un jour un
expert
pourrait
écrire » :
« Rembrandt
a essayé de
dessiner un
cavalier
montant à
cheval, mais
il ne semble
pas avoir
trouvé une
solution...» La
réponse de
Rembrandt ne
nous est pas
parvenue, mais
elle est facile
à imaginer. En
effet, Rembrandt
et son cercle
d'élèves
n'avaient guère
de considération
pour les
critiques d'art,
qui, ne
pratiquant
eux-mêmes ni le
dessin, ni la
gravure, ni la
peinture,
croyaient être
connectés à une
vérité
supérieure (voir
le dessin Satire
du critique
d'art)
Ces exemples
permettent de
comprendre la
difficulté
d'attribution
des dessins à
Rembrandt ou à
ses élèves,
ainsi que la
fragilité
possible des
conclusions
des experts.
Ils montrent
également
qu'il n'est
pas inutile de
savoir
dessiner pour
saisir
pleinement les
dessins et la
méthode de
Rembrandt, en
particulier
pour
distinguer une
étude de
mouvement d'un
dessin achevé.
Satire du
critique d'art,
(c. 1644,
Benesch –
A35a, c. 1638,
Schatborn
&
Hinterding, D
318),
{Metropolitan
Museum of Art,
New York}. Il
s'agit d'une
caricature du
critique
d'art,
dessinée par
Rembrandt ou
l'un de ses
élèves. Ironie
de l'histoire
des
attributions :
Benesch (1973)
attribue ce
dessin à un
élève de
Rembrandt,
tandis que
Schatborn
&
Hinterding
(2019)
l'attribuent
directement à
Rembrandt.
Références
pour ce
paragraphe :
- Benesch
O., 1973, The
Drawings of
Rembrandt (six
volumes),
Phaidon
- Schatborn
P., 1985, Catalogue
of the Dutch
and Flemish
Drawings in
the
Rijksprentenkabinet,
Volume 4,
Rijksmuseum,
Amsterdam,
page 46
- Schatborn
P. & van
Sloten L.,
2014, Old
drawings, new
names,
Uitgeverij de
Weideblik,
Varik and the
Rembrandt
House Museum
- Schatborn
P. &
Hinterding E.,
2019, Rembrandt,
tous les
dessins et
toutes les
eaux fortes,
Taschen
|